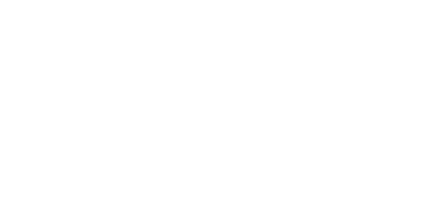Le potentiel de la protection du rhum haïtien en tant qu’appellation d’origine
Johanny Stanley Joseph
Publié le 2 octobre 2025
DOI :
Résumé
La mondialisation, en standardisant les produits et en marginalisant les savoirs locaux, a opportunément renforcé l’enjeu stratégique des indications géographiques (IG). Celles-ci ne se réduisent pas à des simples dénominations géographiques, ces signes publics opèrent comme de véritables instruments juridiques et économiques de différenciation sur l’origine et sur la qualité. Il est donc nécessaire et instructif d’observer la traduction des indications géographiques en une articulation entre protection des consommateurs, valorisation des savoir-faire locaux et compétitivité économique. Leur consécration dans l’Accord sur les ADPIC illustre d’ailleurs assez bien la reconnaissance, au plan multilatéral, de leur rôle dans l’économie mondiale. L’on imagine bien comment cette protection pourrait renforcer la confiance des consommateurs et permettre aux rhums haïtiens d’accéder à de nouveaux marchés.
Entrées d’Index
Mots-clés : appellation d’origine, indications géographiques, protection, valorisation économique
Keywords: appellation of origin, geographical indication, protection, economic valorization
Plan de l’étude
I – La fonction de la protection
A- Quant aux consommateurs
B- Quant aux producteurs
II- La fonction de la valorisation
A- Au plan économique
B- Au plan culturel
Introduction
L’internationalisation des échanges, avec sa dynamique ininterrompue de produits et de savoirs immatériels, a conduit à l’érosion continue des spécificités locales dans un marché globalisé et hyper-standardisé[1]. Cette standardisation normative, loin d’être neutre, menace l’expression diversifiée des savoirs endogènes, lesquels se trouvent absorbés dans une économie de masse. En réaction, producteurs et consommateurs manifestent un intérêt croissant pour l’authenticité, la différenciation et la traçabilité[2]. Dans cet horizon mouvant de la mondialisation, les indications géographiques (IG) et, parmi elles, les appellations d’origine, occupaient déjà hier, et occupent encore aujourd’hui, une place importante dans les discussions internationales sur l’authenticité des produits et la valorisation des savoir-faire locaux[3].
Cristallisant la compétitivité économique dans une économie mondialisée, ces dénominations dites de « terroir » s’érigent non seulement en outils de différenciation commerciale, mais en véritables instruments juridiques et économiques aux multiples fonctions[4]. Il convient, pour en saisir la portée, de revenir à la notion de « terroir », entendue comme une portion de territoire typique où : « une aire géographique particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. Espace délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production, le terroir est fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et un milieu biologique, et un ensemble de facteurs humains. Là se trouvent l’originalité et la typicité du produit »[5], selon la définition de l’INAO.
La place accordée dans ce débat aux indications géographiques mérite d’être éclairée par quelques précisions, que le lecteur trouvera dans la définition de l’OMC. À ce sujet, l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) entend par indications géographiques « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique »[6]. Cette définition, issue de négociations intenses au cours du Cycle d’Uruguay[7], érige les indications géographiques en catégorie stratégique de la propriété intellectuelle, en leur attribuant une importance commerciale capitale[8]. Dès lors, ces thèmes illustrent bien à quel point « les producteurs légitimes peuvent compter sur l’avantage concurrentiel que indications géographiques peuvent conférer tant aux produits agricoles et alimentaires qu’artisanaux et industriels »[9].
Dans cette perspective, considérer la question des indications géographiques ne consiste pas qu’à protéger l’authenticité d’un produit de terroir, il s’agit aussi indirectement d’articuler indissociablement le territoire, le savoir-faire et la culture. C’est en particulier cette relation symbiotique qui confère aux produits des caractéristiques particulières, juridiquement différenciable et économiquement exploitable. Les trajectoires françaises et européenne de l’appellation d’origine, illustrées par des produits emblématiques tels que Bordeaux ou le Cognac, doivent bien entendu être au cœur d’une construction juridique consacrant l’authenticité, la qualité et la réputation. Ces appellations ne sont pas de simples dénominations géographiques, mais bien de véritables paradigmes économiques, fondés sur la différenciation et la valorisation. La jurisprudence européenne[10] n’a cessé d’affirmer cette double fonction de protection et de valorisation, en sanctionnant sévèrement toute usurpation ou évocation susceptible de porter atteinte à leur réputation. Dans le prolongement, la CJUE précise que dans la mesure où ces dénominations sont juridiquement protégées, « elles doivent satisfaire aux objectifs de cette protection, en particulier à la nécessité d’assurer la sauvegarde des intérêts des consommateurs contre les dénominations susceptibles de les induire en erreur »[11].
C’est à la lumière de ces expériences et de cette architecture normative qu’il convient d’interroger la situation haïtienne. Le rhum haïtien reconnu mondialement pour son unicité aromatique, ses caractéristiques gustatives et son ancrage territorial[12], va largement au-delà de la catégorie de simples spiritueux : il s’affirme surtout comme un patrimoine culturel immatériel et vivant d’Haïti. Pourtant, l’absence d’un régime juridique spécifique de protection des appellations d’origine fragilise sa valorisation et expose ce rhum emblématique à la concurrence déloyale. En dépit des obligations de l’Accord sur les ADPIC, avec ses articles d 22 à 24, Haïti est encore privée d’un cadre juridique national de protection[13], alors même qu’elle recèle une forte identité culturelle et dispose de nombreux produits typiques et traditionnels rattachés à des localités particulières[14].
La question est donc moins de savoir si la protection du rhum haïtien en tant qu’appellation d’origine est opportune, que de constater qu’elle constitue une nécessité stratégique : transformer une notoriété fragile en un droit opposable, articulant protection juridique et valorisation économique.
C’est dans cette perspective qu’il convient de méditer, dans une approche prospective-fiction, sur l’institution d’un régime de protection pour le rhum haïtien, en mobilisant les deux fonctions essentielles des appellations d’origines : protection (I) et valorisation (II).
I – La fonction de protection
Pour protéger le rhum haïtien, et donc pour assurer sa valorisation économique, il faut se conformer aux obligations de l’Accord de l’OMC. À l’évidence, nous assistons à un nouveau mode de consommation, tourné vers les indications géographiques. Ces signes publics s’imposent et ont pour fonction directe de protéger les consommateurs contre les dénominations susceptibles de les induire en erreur (A) et, a fortiori, les producteurs contre toute usurpation ou utilisation abusive de telles appellations (B).
A – Quant aux consommateurs
Objectivement, la protection des indications géographiques constitue un mécanisme de sécurisation cognitive et normative pour le consommateur. Chaque produit qui porte une dénomination protégée reflète fidèlement son origine et ses caractéristiques spécifiques[15]. La portée de cette protection ne se limite pas à un rôle informatif : elle juridicise la confiance et érige la typicité et l’authenticité en bien immatériel juridiquement opposable, où la perception du consommateur devient objet de droit. Il y a là l’opportunité de renforcer la crédibilité du produit aux yeux de ces consommateurs[16].
Les indications géographiques sont, dès lors, « porteuses d’informations précises et fiables sur l’origine des produits qu’elles couvrent. Cela dit, le consommateur achetant un produit dont l’étiquette fait mention de l’indication géographique se sent rassuré de ce que les caractéristiques spéciales d’un tel produit sont inhérentes au véritable lieu d’origine »[17]. On peut arguer ici que ce signe opère comme un garde-fou juridique en ce qu’il protège le consommateur contre la tromperie[18] ou utilisation abusive de la dénomination.
Dans le contexte d’un marché saturé de rhums standardisés, la possibilité d’usurpation ou l’utilisation abusive rend la mise en place d’un cadre juridique spécifique particulièrement urgente. L’appropriation de l’appellation « Rhum haïtien » par des opérateurs économiques ne respectant pas le cahier des charges fragilise la confiance des consommateurs et détourne, à leur profit, une réputation historiquement construite. On le sait, ces usages illicites portent souvent sur des produits de qualité inférieure.
Appliquée au « Rhum haïtien », l’indication géographique remplirait la fonction essentielle de garantir l’authenticité de l’origine et des caractéristiques particulières, ce mécanisme qui permettrait aux consommateurs d’identifier un rhum dont la spécificité est due à la fois au terroir, aux techniques traditionnelles de production eau savoir-faire collectif transmis de génération en génération. À n’en pas douter, l’origine apparaît ainsi comme bien davantage qu’une simple dénomination géographique. Elle devient un gage qualité et d’authenticité, consolidant la confiance et matérialisant juridiquement le patrimoine immatériel haïtien.
Faute de jurisprudence haïtienne sur ces points d’ancrage, il est pertinent de se référer aux enseignements de la jurisprudence européenne[19], qui a consacré la protection étendue des appellations d’origine. L’utilisation abusive directe ou l’évocation, fût-elle partielle, d’une appellation susceptible de créer confusion dans l’esprit du consommateur moyen, doit être sanctionnée[20]. L’arrêt Parmesan[21] rappelle que l’évocation indirecte suffit pour porter atteinte à la réputation de l’appellation protégée[22].
Cette jurisprudence instaure un glissement protecteur : il ne s’agit pas seulement de prévenir la fraude, mais de préserver de garantir la fonction naturelle de différenciation de la dénomination. Le signe public devient alors un vecteur du lien irréversible entre le produit et son aire de production, et toute altération de ce lien est juridiquement contestable.
En définitive, l’introduction d’un régime des indications géographiques en Haïti, conforme à l’Accord sur les ADPIC, permettrait de réserver l’usage de la dénomination « Rhum haïtien » aux seuls producteurs respectant le cahier des charges. Cela garantirait aux consommateurs que le rhum acheté répond aux conditions objectives d’origine et de qualité, tout en instaurant un rapport de confiance juridiquement garanti. Les consommateurs ne seraient plus exposés au risque de tromperie, que l’usage abusif émane de producteurs locaux dévoyant les méthodes traditionnelles ou d’opérateurs étrangers.
Ainsi, la fonction de protection à l’égard des consommateurs éclaire et justifie celle exercée en faveur des producteurs : garantir que la dénomination reflète effectivement l’origine et la qualité du rhum implique de conférer aux opérateurs légitimes un droit opposable contre toute usurpation ou utilisation abusive de l’appellation protégée.
B – Quant aux producteurs
La protection que confère l’indication géographique s’inscrit dans une logique qui échappe à l’appropriation individuelle caractéristique du droit des marques, et ce, pour mieux s’instituer dans une dynamique collective, territorialisée et patrimoniale. Tandis que la marque confère un droit privatif attribué de manière singulière à un opérateur économique[23], l’indication géographique octroie un droit collectif fondé sur l’héritage immatériel d’une communauté de savoir-faire[24]. Cette dénomination d’origine et de qualité dépasse alors largement le simple signe distinctif, elle contribue à l’édification d’un bien commun juridique, en contraste aux logiques de monopole individuelle.
Cette dimension collective, on le sait, n’est pas un attribut secondaire : elle constitue le fondement même de la fonction naturelle (protectrice) des indications géographiques à l’égard des producteurs. Ainsi, il est apparu que consacrer un droit d’usage exclusif aux seuls opérateurs légitimes permettrait de réaliser un filtrage normatif et de sanctionner l’usurpation de ces dénominations. En conséquence, ce droit établit une ligne de protection entre la légitimité ancrée dans l’aire géographique de production et l’appropriation illicite par des opérateurs extérieurs.
L’Accord sur les ADPIC illustre ce mécanisme. Son article 22, paragraphe 2, impose aux Membres d’empêcher « l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui traduit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit ». Cette disposition se déploie dès lors dans un arsenal conceptuel et juridique permettant d’étendre la notion d’usurpation et d’articuler ainsi la protection collective de ces signes publics distinctifs.
En première lecture, l’usurpation est prohibée non seulement dans son acceptation la plus large – utilisation de la dénomination sur des produits qui n’en ont pas droits –, mais également dans la suggestivité par laquelle un opérateur extérieur pourrait chercher à profiter indument de la réputation des produits. Autrement dit, une telle disposition postule que l’indication géographique dépasse la seule fonction de signalement d’une qualité déterminée, elle se cristallise en un dispositif juridique érigé contre les pratiques déloyales.
Dans cet univers de concurrence accrue, la dénomination « Rhum haïtien » revêt une importance capitale pour les opérateurs légitimes[25]. L’effort collectif mobilisé afin de construire et maintenir la notoriété d’un produit traduit un investissement en temps, en savoir-faire et en ressources[26]. Protéger cette dénomination revient à sécuriser cet investissement et à garantir aux producteurs légitimes un meilleur revenu[27]. À l’inverse, l’utilisation abusive de la dénomination dans un intérêt commercial illégitime constitue une appropriation illicite de ce capital immatériel et affecte directement les revenus générés par le rhum[28].
Dans la situation haïtienne, l’introduction d’un tel régime de protection serait d’une importance stratégique. L’absence de moyens juridiques de protection des dénominations emblématiques comme « Rhum haïtien » pose deux problèmes au regard de la limitation de la sécurisation des producteurs et de l’authenticité du rhum auprès des consommateurs. Tout d’abord, sur le plan externe, des opérateurs étrangers peuvent, en l’absence de tout blocage réglementaire, exploiter indûment cette dénomination pour designer des rhums élaborés hors du territoire haïtien, portant ainsi atteinte à la réputation des producteurs locaux. Ensuite, sur le plan interne cette fois-ci, ce déficit normatif ouvre la voie aux pratiques concurrentielles déloyales : certains opérateurs économiques contournent les méthodes traditionnelles de production, ce qui pourrait fragiliser la crédibilité du rhum haïtien. Ces deux configurations peuvent être combinés pour dresser le portrait d’un patrimoine immatériel et culturel juridiquement vulnérable, exposé à une concurrence non régulée.
Finissons de nous en convaincre par l’institution du cahier des charges : la délimitation précise des aires géographiques, la prise en compte des conditions pédoclimatiques, les méthodes de fermentation, ainsi que les normes de vieillissement pourraient constituer un véritable mécanisme de protection juridique[29]. Par ce mécanisme, et au croisement entre le droit public (l’État qui encadre et régule) et le droit privé (les producteurs qui exercent un droit subjectif), l’État haïtien confèrerait aux producteurs légitimes la faculté de s’opposer à utilisation abusive, dégagé de sa seule valeur symbolique.
En somme, la protection des producteurs de rhum par l’indication géographique s’articulerait directement avec la protection des consommateurs. Nous l’avons vu, elle assurerait que la dénomination « Rhum haïtien » reflète fidèlement son origine et ses caractéristiques spécifiques, tout en valorisant le savoir-faire collectif qui fonde son authenticité. Cette double fonction, méditée dans cet article, – économique et juridique – pourrait protéger à la fois les producteurs légitimes de rhum et les consommateurs contre toute usurpation ou utilisation abusive de ladite appellation.
Le droit, en réservant la dénomination « Rhum haïtien » aux seuls producteurs légitimes, consacre l’authenticité comme un capital stratégique. Cette réservation constitue la condition sine qua non de sa valorisation et de sa renommée sur le plan international.
II – La fonction de valorisation
[6] Art. 22 Accord sur les ADPIC.
[7] J. S. Joseph, La protection juridique des indications géographiques et son avantage pour le développement d’Haïti, thèse de doctorat, Université de Bordeaux, IRDAP, 2024, p. 15.
[8] J. S. Joseph, op., cit. p. 16.
[9] Ibid., p. 16.
[10] CJCE, 20 février 1975, Commission européenne c/ République Fédérale d’Allemagne, aff. 12/74.
[11] Ibid., point 7.
[13] J. S. Joseph, op., cit. p. 20.
[14] Ibid.
[16] Considérant 19 du règlement (UE) n° 2024/1143.
[17] Ibid., p. ….
[18] CJUE, 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB, aff. C-783-19, point. 4 ; CJCE, 20 février 1975, Commission européenne c/ République Fédérale d’Allemagne, aff. 12/74, point.1.
Référence électronique
Johanny Stanley Joseph, « Le potentiel de la protection du rhum haïtien en tant qu’appellation d’origine », Open Economic Law, [En ligne], 10 | 2025, En ligne le 2 octobre 2025. URL : https://openeconomiclaw.com/; DOI : https://doi.org/10.
Auteur
Johanny Stanley Joseph
Johanny Stanley Joseph est professeur à l’Université d’État d’Haïti (UEH) ainsi que chercheur associé au Centre de Recherche en Droit Économique. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en droit privé à l’Université de Bordeaux (France) en 2024 sur « La protection juridique des indications géographiques et son avantage pour le développement d’Haït », il poursuit ses recherches sur la protection des droits de propriété intellectuelle, avec une attention particulière aux mutations induites par l’intelligence artificielle et à leurs implications sur les régimes nationaux et internationaux.
[email protected]